Q&R : Et si on utilisait la lumière pour soigner le diabète ?
Marie-Marthe Chabi, est une jeune chercheure béninoise spécialisée en biologie du développement, inscrite en thèse de doctorat en sciences biologiques à l’unité de recherche sur les maladies non transmissibles et le cancer, de l’université d’Abomey-Calavi du Bénin et à l’UPMC de l’université de Sorbonne en France
Elle fait partie des 30 lauréates du 15e Prix Jeunes Talents Afrique subsaharienne 2024 décerné par la Fondation L’Oréal et l’UNESCO pour les Femmes et la Science.
Notamment pour ses travaux sur la photobiomodulation qui est un nouveau champ de recherche qui vise à mettre au point une solution pour une meilleure prise en charge des patients diabétiques de type 2.
“Nous utilisons un dispositif utilisant la lumière rouge ou infrarouge afin de réduire le stress oxydatif qui est retrouvé dans plus de 90% des cas de diabète de type 2. Dans la prévention et la prise en charge de cette maladie, le stress oxydatif est un facteur qui est trop souvent négligé”
Marie-Marthe Chabi, université d’Abomey-Calavi
Dans cet entretien avec SciDev.Net, Marie-Marthe Chabi partage sa passion pour la recherche scientifique, l’intérêt de ses travaux et sa contribution à la lutte contre le diabète de type 2 en Afrique, entre autres…
Vous avez réalisé une étude sur un procédé permettant d’utiliser la lumière pour réduire le taux de sucre dans le sang. De quoi s’agit-il concrètement ?
Nous utilisons un dispositif utilisant la lumière rouge ou infrarouge afin de réduire le stress oxydatif qui est retrouvé dans plus de 90% des cas de diabète de type 2. Dans la prévention et la prise en charge de cette maladie, le stress oxydatif est un facteur qui est trop souvent négligé.
En effet, le stress oxydatif est une menace silencieuse qui provoque le vieillissement accéléré de nos cellules et augmente les risques de maladies cardiovasculaires, infections, cancers, etc… S’il n’est pas maîtrisé, les conséquences peuvent être très lourdes.
Ce genre de thérapie est non invasif, simple à appliquer, sans effets secondaires, et n’implique pas l’utilisation de médicaments supplémentaires. Une amélioration du déséquilibre glycémique pourrait être une conséquence directe du traitement.
Comment est né ce projet ?

Ce projet est né du constat de l’impact socio-économique négatif que représente le diabète de type 2 pour la société et le patient. Etant proche de personnes vivant avec cette maladie et voyant le fardeau que cela représente pour elles et leurs familles au niveaux financier, physique et mental, il paraissait important de tester une solution capable dans une certaine mesure d’apporter du soulagement.
Quel est l’intérêt de votre recherche et comment les résultats obtenus peuvent-ils contribuer à la lutte contre le diabète en Afrique ?
Notre objectif premier est de démontrer qu’il est possible pour les patients souffrant du diabète de type 2 d’obtenir une meilleure prise en charge. Ceci, afin de prévenir ou de ralentir la survenue de maladies secondaires aux DT2, car ce sont ces dernières qui fragilisent vraiment le patient.
In fine, il s’agit vraiment de réduire le lourd fardeau que constitue la prise en charge du diabète mais aussi l’impact sur l’économie de nos pays. Les chiffres de l’OMS, révèle davantage l’intérêt de cette solution que nous proposons.
En effet, selon les estimations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), en 2021, environ 24 millions de personnes étaient atteintes de diabète en Afrique, et ce chiffre devrait passer à 55 millions en 2045, soit une augmentation de 129 %. Nous voudrions donc contribuer à inverser la tendance.
Grace à votre recherche, vous êtes l’une des lauréates du Prix Jeunes Talents Afrique subsaharienne 2024, décerné par la Fondation Oréal et l’UNESCO. Qu’est-ce que cette distinction représente pour vous ?
C’est la reconnaissance d’un travail acharné qui est réalisé sur un terrain qui n’est pas toujours favorable à l’apprentissage et à l’épanouissement. C’est la raison pour laquelle nous avons besoin de plus d’initiatives de ce genre pour nous apprendre à croire en nous, nous dépasser et connaître le succès dans ce choix de carrière.
Je suis toute heureuse de cette reconnaissance qui va être un coup de pousse à ma détermination et à mon engagement à contribuer à résoudre ce problème de santé publique lié au diabète.
Où en êtes-vous donc avec ces travaux ?
Je suis à la seconde étape sur trois. Il faut conduire des études en laboratoire puis des études cliniques. Je remercie la Fondation L’Oréal et l’UNESCO pour ce prix qui me permettra de clore cette seconde étape et de soutenir ma thèse.
En raison des fonds importants qu’implique la recherche scientifique, des contributions comme celles-ci seront les bienvenues. Il faudra aussi aller les chercher pour effectuer un travail de qualité après la thèse et oser prétendre à un produit fini pour améliorer la santé des diabétiques de type 2 dans nos communautés.
Malgré des progrès enregistrés, les femmes africaines en science sont toujours confrontées à des préjugés liés au genre, au difficile accès aux financements de leurs travaux. Avez-vous été victime de ces préjugés ou difficultés ?
Oui, mais ils sont subtils ; ce qui entame forcément l’estime de soi. Je n’avais pas d’autres choix que de faire avec et de trouver des stratégies pour me concentrer sur ce que je voulais.
Justement, comment les avez-vous surmontés ?
J’ai développé différentes approches, comme suivre des formations spécifiques pour acquérir ou renforcer mes compétences afin de maximiser mes chances, apprendre à m’aimer pour ne pas souffrir du regard des autres, accepter la critique comme un levier d’amélioration, cultiver l’amour du travail bien fait et apprendre à m’adapter aux situations imprévues.
Quelles sont, selon vous, les actions à mener pour encourager et accroître la présence des femmes dans les domaines scientifiques en Afrique ?
De mon point de vue, et sur la base de mon expérience personnelle, la femme a du potentiel qu’il faudrait valoriser pour le bien de la société, que ce soit dans le domaine de la recherche scientifique ou dans tout autre domaine.
Alors, pour encourager et accroître la présence des femmes dans les domaines scientifiques en Afrique, il faut promouvoir l’égalité des chances. En plus, de cela, il faudrait inclure les hommes qui sont majoritaires dans les prises de décision dans la prise de conscience de l’importance des femmes dans ces domaines scientifiques.
La tolérance des femmes dans le milieu du travail pourra constituer un levier clé. Au-delà de ces actions, inclure des mentors à différentes étapes de la vie scolaire et académique pour accompagner les filles et les femmes.
••••••
➤ Bien que nous ayons mis en place un processus éditorial robuste et bien rodé, nous ne sommes qu’humains. Si vous repérez des erreurs ou des coquilles dans nos productions, veuillez-nous en informer par courriel à l’adresse : correction@sciencesdecheznous.com.
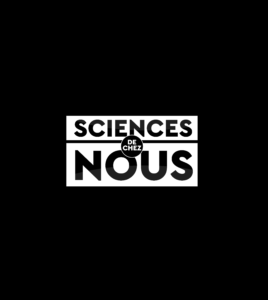


Les commentaires sont fermés.