Dans un pays où le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans est estimé à 89 pour 1 000 naissances vivantes (EDS-M VII 2023-2024), et où certaines femmes continuent d’accoucher sans assistance qualifiée, la question de l’allocation équitable des ressources se pose avec acuité.
Selon les dernières données du Système local d’information sanitaire (DHIS2, 2023), le paludisme reste la première cause de morbidité (37,7 %) et de mortalité (24,4 %), au Mali. Ces chiffres, rappelés par Aïssata Koné, directrice du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), montrent à quel point la situation est critique.
Terrorisme et maladies, un bilan comparé
En 2022, le Mali a enregistré environ 944 décès dus au terrorisme, répartis entre civils (64 %) et militaires (20 %), avec une augmentation notable de la létalité des attaques malgré une baisse du nombre d’incidents. Ces violences sont concentrées principalement dans les zones frontalières du Sahel, où les groupes djihadistes intensifient leurs actions, causant une crise sécuritaire majeure.
En parallèle, les maladies restent la principale cause de mortalité dans le pays, avec le paludisme en tête : il a provoqué environ 1 498 décès en 2022, tandis que les maladies non transmissibles (cardiovasculaires, cancers, diabète) ont causé environ 46 700 décès en 2023 selon l’OMS.
Cette comparaison met en lumière un contraste frappant : les maladies tuent chaque année autant, voire plus, que les conflits armés.
Un problème de financement ciblé
Ces données ne traduisent pas nécessairement un manque de volonté politique, mais plutôt l’absence de mécanismes de financement ciblé, transparent et durable, notamment pour le secteur de la santé. À défaut de dispositifs clairs d’affectation budgétaire, une part significative des recettes issues de la fiscalité – y compris celles générées par la téléphonie mobile – risque d’être absorbée par d’autres urgences nationales, sans impact direct ou mesurable sur les soins de santé de base.
Cette réalité, souvent évoquée par des acteurs de la société civile et des spécialistes de la santé publique, alimente le débat. C’est notamment la position défendue par le Dr Mohamed Ali Ag Ahmed, coordinateur du Réseau Afrique francophone & fragilité (AFRAFRA).
Des propositions concrètes sur la table
Dans une tribune, il met en garde contre le risque que cette manne fiscale, sans cadre de gestion transparent et orienté, passe à côté de son potentiel transformateur : « Sans des mécanismes rigoureux et transparents, cette ressource pourrait manquer sa mission première : celle de contribuer à sauver des vies. »
Ce n’est pas une proposition théorique. Dr Mohamed propose une réforme concrète : la création d’un Fonds national pour la santé, assorti d’un cadre légal imposant qu’un pourcentage défini (entre 20 et 30 %) des recettes issues de la fiscalité télécom soit alloué au secteur sanitaire.
Des exemples existent pourtant. Le Dr Mohamed suggère de s’inspirer de pays comme le Ghana ou le Rwanda, non pour copier un modèle, « mais pour intégrer les principes de transparence, de ciblage budgétaire et de redevabilité qui ont permis à ces États d’améliorer la gouvernance dans les secteurs sociaux. »
Dans sa tribune, l’expert insiste sur la « participation active des acteurs de santé – professionnels, patients, ONG – dans la définition des priorités et le contrôle de l’usage des ressources ». Ce sont eux qui, au quotidien, savent où chaque franc investi peut réellement faire la différence.
Il ne s’agit pas ici de remettre en cause des choix souverains de gestion ou de porter des accusations, mais plutôt d’ouvrir un débat citoyen et technique, à partir de données, de comparaisons avec d’autres pays africains et de faire des propositions concrètes. Car la fiscalité numérique est une chance – encore faut-il lui donner une direction claire, équitable et utile au bien commun.
Comme le souligne le Dr Mohamed Ali Ag Ahmed, « il ne faut pas manquer cette fenêtre d’opportunité qui s’ouvre pour le financement du secteur de la santé. Nos pays se sont engagés à consacrer au moins 15 % de leur budget national annuel à la santé, mais en 2020, la part dédiée à la santé au Mali était encore inférieure à 8 %, ce qui reste très insuffisant. »
Il est donc urgent de mettre en place des mécanismes transparents pour mieux mobiliser et utiliser les ressources, notamment celles issues de la fiscalité sur la téléphonie mobile.
Cette démarche est d’autant plus importante que, comme le rappelle l’OMS, « la moitié des décès d’enfants de moins de cinq ans dans le monde pourraient être évités par un accès équitable à des soins de santé de base. »
••••••
Cet article a été écrit par Mardochée BOLI et approuvé pour publication par la rédactrice en chef de Sciences de chez Nous, Fatimatou Diallo.
➤ Bien que nous ayons mis en place un processus éditorial robuste et bien rodé, nous ne sommes qu’humains. Si vous repérez des erreurs ou des coquilles dans nos productions, veuillez-nous en informer par courriel à l’adresse : correction@sciencesdecheznous.com.
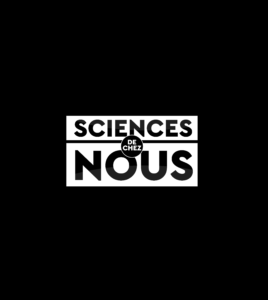


Les commentaires sont fermés.