Le cinquième Prix Hideyo Noguchi pour l’Afrique, plus haute distinction médicale décernée tous les trois ans par le gouvernement japonais, a été attribué en 2025, dans la catégorie services médicaux, à la Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi), organisation internationale à but non lucratif engagée dans la recherche médicale. Le Prix comprend 677 mille dollars US, un certificat et une médaille pour les lauréats.
Remis en marge de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD), ce prix consacre plus de vingt années de travaux de DNDi pour mettre au point et rendre accessibles des traitements innovants contre les maladies négligées, notamment la maladie du sommeil, la leishmaniose et la maladie de Chagas.
La cérémonie s’est tenue le 22 août 2025 à Tokyo, en présence de l’empereur et de l’impératrice du Japon, sous la présidence du Premier ministre Shigeru Ishiba.
Dans la foulée de cette distinction, Chirac Bulanga, directeur régional de DNDi en République démocratique du Congo, a accordé une interview à Sciences de chez Nous.
Sciences de chez Nous : Que représente ce Prix Hideyo Noguchi pour DNDi et, surtout, pour les millions de patients africains touchés par les maladies négligées ?
Chirac Bulanga : Ce prix constitue une reconnaissance internationale majeure du travail de DNDi en faveur des patients les plus vulnérables et les plus oubliés. Il vient couronner plus de deux décennies d’efforts pour développer et rendre accessibles des traitements innovants contre des maladies trop souvent négligées par la recherche, les financements et, plus largement, par les systèmes de santé mondiaux. Pour des millions de patients africains, cette distinction symbolise la reconnaissance de leur combat, de leur dignité, mais aussi leur droit effectif à l’accès aux soins et à la justice sanitaire.
Pensez-vous que cette reconnaissance internationale aidera à attirer plus de financements et d’innovations pour l’Afrique ?
Absolument. Le Prix Hideyo Noguchi offre une visibilité mondiale à DNDi et, plus largement, à la cause des maladies négligées. Cette distinction peut contribuer à mobiliser de nouveaux financements, à renforcer les partenariats scientifiques existants et à encourager les bailleurs institutionnels comme privés à investir davantage dans des solutions adaptées aux réalités africaines. Elle envoie aussi un message fort : l’innovation médicale en Afrique mérite d’être célébrée et soutenue par l’ensemble de la communauté internationale.
Quels partenariats africains aimeriez-vous renforcer à la suite de ce prix ?
DNDi collabore déjà avec de nombreuses institutions africaines, qu’il s’agisse des programmes de lutte contre les maladies dans les pays endémiques ou de centres de recherche locaux comme l’Institut national de recherche biomédicale (INRB) en RDC ou l’Institut Pasteur de Guinée. Ce prix constitue une opportunité de consolider ces collaborations et d’en nouer de nouvelles, notamment avec des universités, des institutions de recherche, des laboratoires de santé publique et les ministères de la Santé. C’est tout un modèle collaboratif que cette distinction peut encore renforcer.
Vous avez développé le premier traitement oral contre la maladie du sommeil. Qu’est-ce que cela change concrètement pour les patients et les systèmes de santé en Afrique ?
Le Fexinidazole, premier traitement entièrement oral, a transformé la prise en charge de la maladie du sommeil. Autrefois, les patients étaient traités avec des médicaments à base d’arsenic, extrêmement toxiques. Aujourd’hui, grâce à un simple traitement en comprimés, la vie des patients et des praticiens est considérablement facilitée. C’est un médicament à la fois sûr, efficace et facile à administrer, qui allège la charge des systèmes de santé en Afrique tout en améliorant significativement l’accès aux soins.
Parmi vos 13 traitements déjà mis à disposition, lesquels ont eu l’impact le plus fort en Afrique, et pourquoi ?
Je citerais d’abord le Fexinidazole, premier traitement entièrement oral contre la maladie du sommeil, disponible depuis 2018 dans tous les pays endémiques. Ensuite, la combinaison Miltefosine-Paromomycine, utilisée contre la leishmaniose viscérale en Afrique de l’Est. Enfin, le Benznidazole pédiatrique, première formulation adaptée aux enfants pour traiter la maladie de Chagas. Ces trois traitements se distinguent par leur accessibilité, leur simplicité d’administration et surtout par leur adaptation aux réalités du contexte africain.
Comment DNDi travaille-t-elle avec les chercheurs, les laboratoires et les gouvernements africains pour renforcer la capacité locale en matière de recherche et développement ?
Nous avons adopté un modèle collaboratif qui associe les chercheurs africains dès les premières étapes de la recherche et du développement. Ce modèle favorise la formation, le transfert de compétences, la mise en place d’infrastructures locales et même la réhabilitation de structures existantes. La plupart des essais cliniques sont conduits en Afrique, en partenariat avec des institutions locales et régionales, ce qui renforce à la fois l’expertise scientifique et l’autonomie des pays endémiques.
La lutte contre les maladies négligées dépend aussi de la confiance des communautés. Comment DNDi prend-elle en compte les réalités sociales, culturelles et la stigmatisation liée à ces maladies ?
DNDi place les patients au cœur de ses choix scientifiques. Ils sont au centre de toutes nos activités. Nous travaillons en étroite collaboration avec les communautés pour comprendre leurs besoins, leurs croyances et leurs contraintes. Cela nous permet de développer des traitements plus simples, non invasifs et mieux adaptés aux réalités locales. Concrètement, nous collaborons avec les gouvernements, les programmes de santé du ministère, ainsi qu’avec les leaders communautaires. Ensemble, nous menons des actions de sensibilisation qui contribuent à réduire la stigmatisation et à favoriser l’adhésion aux soins dans toutes les couches de la population.
••••••••••
Cette interview a été transcrite par Ruth Kutemba pour Sciences de chez Nous.
➤ Bien que nous ayons mis en place un processus éditorial robuste et bien rodé, nous ne sommes qu’humains. Si vous repérez des erreurs ou des coquilles dans nos productions, veuillez-nous en informer par courriel à l’adresse : correction@sciencesdecheznous.com.
Pour toutes autres préoccupations
Envoyez-nous un email
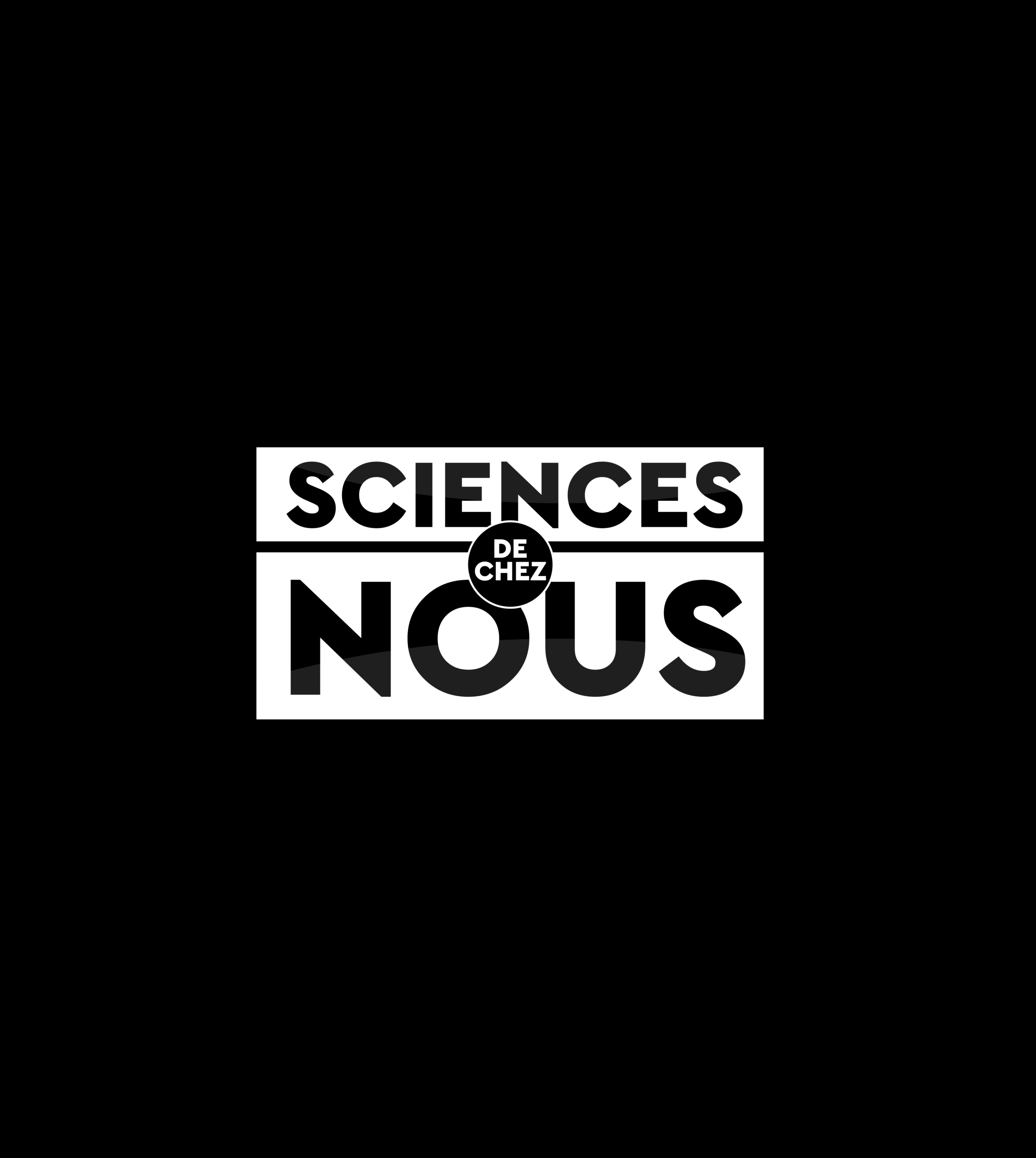


Les commentaires sont fermés.